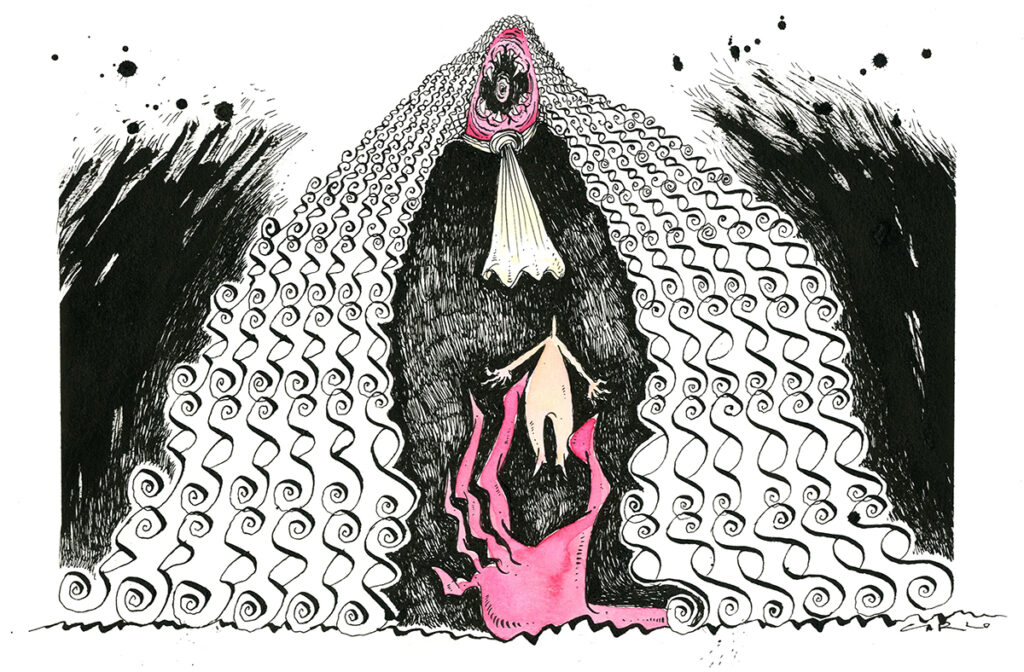
En 2008, la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille (loi dite AEF) entre en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg1. A l’époque, cette loi est prometteuse. Cependant, la mise en œuvre s’est fait attendre jusqu’en 2011, les ambitions affichées se sont heurtées à un ensemble d’obstacles et l’évolution sociodémographique du pays a, sans cesse, questionné le système d’aides en place. Ainsi, après plus d’une décennie de mise en œuvre, l’heure est venue de réfléchir à de nouveaux cadres légaux avec le projet de loi n° 79942 et le projet de loi n° 79913. Le premier réunira dans un même texte législatif « l’aide et le soutien aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles » ainsi que « la protection » de la jeunesse. Une laborieuse entreprise législative se dessine alors : rassembler en une seule loi ce que deux proposaient jusque-là. Le second s’attachera à définir un droit pénal pour mineurs. Dans ce contexte se pose dès lors la question des enjeux pour le secteur social du pays.
Des constats regrettables
En 2014, un premier bilan de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg (FEDAS Luxembourg) concernant trois années de mise en œuvre de la loi AEF met en avant différents constats : une évolution positive du système d’aides ; des problématiques transversales ; un cadre légal qui souffre déjà de certaines limites.
Pour la première fois, il était fait mention dans une loi du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une évolution législative positive dotait le pays d’une valeur forte pour les droits humains et leurs applications. A ce principe s’adjoignait la création de l’Office national de l’enfance (ONE) comme institution garante de « la mise en œuvre de l’aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse ». Pour réaliser la coordination de l’aide, un nouveau métier dans le domaine du travail social a été créé : les coordinateurs de projets d’intervention (CPI), qui composaient le personnel de trois associations sans but lucratif dédiées à cet objectif. Deux piliers venaient d’être édifiés : un organe exécutif central de l’aide et des moyens pour coordonner celle-ci. De plus, le législateur s’était saisi de la nécessité de répondre aux multiples besoins des populations visées par la loi. En ce sens, toute une panoplie d’aides y a été précisée. Ce constat est essentiel pour le travail social : avoir une loi qui concède une diversité d’aides, de sorte à avoir les moyens d’adapter l’action sociale en conséquence. Une loi idéale, en somme. A partir de cette diversité, le secteur de l’aide à l’enfance et à la famille s’est restructuré et développé avec de nouveaux services et de nouvelles structures. Cette évolution a également été soutenue par l’établissement d’un dialogue structuré entre l’Etat et, entre autres, les organismes gestionnaires, prestataires d’aides. Il s’agissait de favoriser des échanges constants entre le secteur social et les décideurs politiques. Des représentants de l’Université du Luxembourg y étaient également associés. Cet élément est un autre constat positif : doter les pouvoirs publics d’une collaboration avec la société civile et savante. A partir de ces grandes lignes, la loi AEF amorçait un tournant dans le champ de l’action sociale dédiée aux enfants et aux familles.
Seulement voilà, il y a la théorie et il y a la pratique de la loi. Toujours dans le cadre du bilan de mise en œuvre de la loi, divers points ont été soulignés, comme par exemple l’intérêt de l’enfant et celui de la famille, parfois malmenés par des considérations administratives, financières et territoriales ; une non-réponse légale en matière de secret professionnel et de secret professionnel partagé ; le rôle de l’ONE se réduisant à une distribution d’accords de prise en charge et de financement lié, etc. Cette énumération n’est pas exhaustive. Il est question ici de souligner les sujets souvent débattus dans le cadre du dialogue structuré pour que la pratique de l’action sociale ainsi que sa qualité ne soient pas empêchées. Si nous reprenons les quatre piliers (cf. déjudiciarisation, prévention, coordination et participation) qui ont forgé la loi AEF, force est de constater que les objectifs n’ont pas été atteints : la majorité des aides se réalise sous injonction de la justice, la coordination s’exerce dans des contextes « judiciarisés », la participation des bénéficiaires s’est limitée à des considérations bureaucratiques ou financières et la prévention a peu été portée par les pouvoirs publics.
Toutefois, le législateur, observateur également de ces nombreuses limites, s’est inscrit dans une dynamique de changement important de l’aide à l’enfance et à la famille ainsi que de la protection de la jeunesse pour, d’une part, répondre aux déséquilibres existants et, d’autre part, à une mise en conformité avec les directives européennes en matière d’aide et de protection de l’enfance. C’est à partir de ces axes que le projet de loi n° 7994 a été déposé à la Chambre des députés le 25 avril 2022.
Des évolutions nécessaires
Une des premières évolutions législatives est la place centrale accordée à la Convention internationale des droits de l’enfant. Au détour du texte législatif en dépôt, différents droits peuvent être relevés. Jusqu’alors, aucun de ces droits n’était clairement énoncé dans les lois en vigueur, même si des références vagues y étaient faites.
Une évolution, longtemps demandée par la FEDAS Luxembourg, notamment dans son avis sur le projet de loi n° 7276, est la séparation des dispositions législatives en matière de protection et de répression des mineurs en conflit avec la loi. En effet, ce projet de loi était peu éclairant sur cette distinction, créant toute une série de confusions. Grâce aux avis d’experts nationaux et internationaux, le législateur a pris le parti de proposer en une seule loi ce qui relève de l’aide et de la protection, laissant le volet pénal être l’objet d’un autre projet de loi dédié. Cette démarche donne une cohérence au futur cadre légal : un seul système juridique garantit la défense sociale des populations visées.
Sur le terrain, nombre de professionnels constatent des situations d’enfant, de jeune adulte et de famille pris dans une spirale infernale de problèmes divers. Ainsi, ils se posent des questions quant aux possibilités de venir en aide de manière pertinente, dans un contexte où l’action sociale n’a pas été soutenue pour empêcher ces familles d’atteindre un tel niveau de détresse. Le développement de la prévention peut être une réponse apportée par le projet de loi n° 7994. En effet, prévenir est une étape importante, car elle permet, autant que possible, d’éviter que des situations personnelles et familiales se dégradent de telle manière au fil du temps que l’action sociale peut se trouver démunie en termes de réponses à apporter. Le projet de loi en dépôt promeut également différents niveaux de prévention afin d’empêcher que des enfants aidés deviennent des enfants placés, voire deviennent, à leur tour, des parents aidés.
Longtemps défini comme tel, l’ONE est réaffirmé comme l’instance nationale centrale de l’aide, du soutien et de la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Ses missions sont développées et étendues pour centraliser tout ce qui relève de l’accueil en famille et du recueil d’informations préoccupantes. Pour ce dernier point, il peut être mis en avant la volonté de créer un organe interne à l’ONE, la Commission de recueil des informations préoccupantes (CRIP), « efficace » et « réactif » en matière de protection et de lutte contre la maltraitance. A ces dispositions s’ajoute une base légale à l’implémentation du concept de protection dans tout contexte d’aide, de soutien, de protection et d’enseignement. C’est un moyen législatif concret de lutte contre la maltraitance institutionnelle. Dans cette prescription, on peut y voir le soutien idéologique au développement d’une pratique du « prendre soin » et, nous pouvons le formuler ainsi, du « bien » « prendre soin » des enfants, des jeunes adultes et des familles.
Une autre évolution positive tient aux dispositions projetées en matière de maintien de l’autorité parentale dans le cadre du placement d’un enfant. Actuellement, les dispositions en vigueur prévoient le transfert de cette autorité parentale aux prestataires en cas de séparation décidée par la justice. Ce transfert ne sera plus systématique dans le nouveau cadre légal. Ce principe est important pour soutenir la continuité des liens familiaux durant le processus d’aide. Le maintien de l’autorité parentale sera également un autre moyen de favoriser la participation des parents en tant qu’acteurs de l’aide. A cette future disposition s’ajoute la distinction importante entre actes usuels (p. ex. aller chez le coiffeur) et actes non usuels (p. ex. demande d’émancipation) comme délimitation des décisions pouvant être prises par un tiers.
Les droits des enfants, des jeunes adultes et des familles se veulent irréductibles, car il s’agit de droits humains fondamentaux.
L’un des points nébuleux qui subsistait était la difficulté, voire l’impossibilité d’une communication professionnelle partagée entre différents acteurs pour le bien-fondé d’une prise en charge sociale adaptée. S’il y a un élément qui ressort des différents échanges entre l’Etat, les organismes gestionnaires et la justice, c’est ce besoin essentiel de coopérer. Sans communication, il ne peut y avoir d’aide, de soutien et de protection véritable. Encore faut-il lui donner un cadre suffisamment développé pour en permettre ses effets au bénéfice des dispositifs envisagés.
A travers ledit projet de loi, de nombreuses promesses d’évolution de l’aide, du soutien et de la protection des populations vulnérables visées sont faites. Il n’en demeure pas moins que se posent sans cesse des questions concernant leur mise en pratique. Le passé nous enseigne, nous renseigne et nous rend attentif à des points cruciaux pour l’avenir.

Des réflexions notoires
L’aide et la protection de l’enfant, du jeune adulte et de la famille sont des sujets sensibles, car elles sont complexes et multiples. Aussi, toutes les réflexions ne pourront pas être présentées ici, car elles sont de fait nombreuses, comme le suggère la diversité des évolutions portées par le texte législatif sous projet. Nous nous limiterons dès lors à trois réflexions essentielles.
De notre point de vue, les droits des enfants, des jeunes adultes et des familles se veulent irréductibles, car il s’agit de droits humains fondamentaux. Ainsi, notre compréhension se heurte à la volonté du législateur de conférer « un droit à la demande d’aide » plutôt qu’« un droit à l’aide ». Toutefois, il existe dans le futur texte légal des explications tenant au fait que l’introduction d’un droit de recours suffit à répondre au droit à l’aide. Cependant, combien de mineurs, combien de jeunes adultes, combien de familles éprouvant des difficultés se permettront de déposer un recours face à un refus d’aide ? Sans trop nous avancer, la réponse est toute trouvée : pratiquement aucun(e). Ainsi, d’autres questions se posent par rapport à ce « droit à demander de l’aide » : lorsqu’il y a la volonté de défendre les droits, pourquoi les restreignons-nous ? Il existe des risques, peu explicites mais entendables : il faut pouvoir financer un potentiel afflux d’aides ; il faut pouvoir répondre, structurellement, à toutes les demandes sans exception, etc. En avons-nous les moyens ? Nous ne le savons pas. Pourquoi ? Parce qu’aucune donnée consolidée n’existe sur le territoire, qu’aucune projection n’est apparemment possible et donc aucune anticipation de ce flux ne peut s’organiser. A cela s’ajoute, à ce jour, le manque d’information relative aux critères orientant la décision d’octroi ou de refus d’une mesure d’aide, de soutien ou de protection. Quelques zones d’ombre persistent, malgré une certaine transparence affichée par le législateur.
Une autre thématique qui interpelle est celle de la qualité. Dans le cadre de l’aide sociale, comment appréhender cette qualité ? Un des instruments développés à cet effet est le cadre de référence national, dédié à implémenter la qualité auprès des prestataires de service. Cependant, qu’en est-il de l’approche qualité au niveau du système d’aides dans son ensemble ? Quelques réponses sont données dans ledit projet de loi : il y a, à de nombreux endroits du texte législatif, la volonté d’être éclairé par la collecte et l’analyse de données recueillies par quatre organes différents de l’Etat, et ce, dans le but de servir les décisions et les orientations politiques en la matière. Cependant, la qualité du système d’aide telle que projetée risque de souffrir d’une approche morcelée si elle n’est pas pensée de manière holistique.
Tout système d’aide implique nécessairement différents acteurs qui participent à son fonctionnement. Dans le contexte législatif envisagé, il y aurait comme acteurs le(s) bénéficiaire(s), le(s) prestataire(s), les agents de l’ONE, potentiellement la CRIP ainsi que des agents du parquet, voire le juge de la jeunesse. Au mieux, le bénéficiaire serait en relation avec deux interlocuteurs (un prestataire et un agent de l’ONE), au pire, avec une multitude d’interlocuteurs (prestataires, agents de l’ONE, agents de la CRIP, agents du parquet, juge de la jeunesse). Dans cette acceptation, il est fondamental que le bénéficiaire ou futur bénéficiaire de l’aide puisse identifier une personne de référence, une personne garante de repère et de continuité dans l’aide offerte. Cette personne de référence pourrait être un agent de l’ONE. De plus, notons le changement de paradigme à travers l’introduction de la CRIP. Il importe que cette instance soit mûrement réfléchie dans ses modalités de fonctionnement pour servir la protection de l’enfance : il est primordial de penser en amont des procédures précises et efficaces afin d’éviter des « dérapages » ou des discontinuités dans le processus d’analyse d’une situation préoccupante, au détriment de l’enfant concerné. Comme souligné précédemment, le rôle de l’ONE, comme organe central des dispositifs, est essentiel. Il est soutenu par les organismes gestionnaires à bien des égards. Outre son rôle central auprès des prestataires et autres interlocuteurs de l’Etat, il devrait également avoir cette qualité auprès du bénéficiaire. Cette approche globale donnerait de la cohérence à l’organisation de l’aide, des repères aux bénéficiaires de l’aide, un périmètre clarifié de ses rôles et de ses missions.
Pour conclure
Nous souhaitons la réforme, nous la voulons, nous la demandons et nous nous rendons disponibles pour y réfléchir avec vous, cher lecteur, et également avec tout acteur qui le souhaiterait. Ce qui compte, à partir de ce point de vue, est de permettre un éclairage issu d’une longue expérience de la pratique et de l’organisation de l’aide à l’enfance et à la famille. En outre, nous appelons à ce que les principes fondateurs du projet de loi n° 7994 ne rencontrent pas les mêmes écueils que par le passé. Il importe qu’un juste équilibre soit trouvé pour garantir aux enfants, aux jeunes adultes et aux familles une aide, un soutien et une protection s’ils en éprouvent le besoin. Il importe que tous les organismes gestionnaires et tous les professionnels de terrain trouvent des réponses aux obstacles auxquels ils se heurtent aujourd’hui et se heurteront demain. Il en va de l’harmonie de notre société dans ce champ de l’action sociale.
Pascaline K’Delant, PhD en psychologie et psychologue, diplômée en criminologie et en psychothérapie, a une expérience de près de vingt ans dans le secteur social et de près de dix ans en tant qu’enseignant–chercheur en France et au Luxembourg. Depuis dix ans, elle est chargée de mission à la FEDAS Luxembourg dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la famille. Cette ASBL représente 185 organismes membres, gestionnaires de structures dans les différents secteurs de l’action sociale au Luxembourg : enfance, jeunesse et famille, seniors, aide sociale, handicap, protection internationale, inclusion sociale et professionnelle, etc. www.fedas.lu
1 Cet article utilise principalement le masculin générique. Toute référence à des personnes s’applique à toutes les formes de genre.
2 Projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles.
3 Projet de loi n° 7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
