Le reflet du travail de l’EPI dans le nouveau cadre légal sur la protection de la jeunesse
« […] l’enfant, pour l’accomplissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension […] [Or,] dans tous les pays du monde des enfants […] vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et […] il est donc nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière1. »
Le nouvel article 31 du futur texte de notre Constitution2, selon lequel « [d]ans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale », reprend l’esprit d’une déclaration de la Société des Nations3, qui déjà en 1924 avait mis l’accent, dans une formule concise et un langage propre à l’époque, sur le droit au développement matériel et spirituel normal des enfants, afin que « l’enfant qui a faim [soit] nourri, […] que l’enfant arriéré [soit] encouragé, que l’enfant dévoyé [soit] ramené, que l’enfant orphelin ou abandonné [soit] recueilli et secouru ».
Les objectifs du projet de loi n° 7994 sur la protection de la jeunesse, qui a été déposé en avril 2022 à la Chambre des députés, s’y alignent, en centrant les efforts en matière de protection de la jeunesse sur la promotion des droits de l’enfant, en avantageant la prévention plutôt que les interventions réparatrices et en prévoyant de hauts standards de qualité pour l’encadrement de jeunes en mal d’insertion sociale.
Qu’est-ce que la Fondation EPI ?
Ce n’est pas sans fierté que la Fondation EPI note que son objet social tout comme la philosophie de son travail au quotidien reflètent les exigences de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies et les ambitions du nouveau projet de loi. En effet, ses buts sont les suivants :
- Encourager les jeunes qu’elle a pris en charge à relever les défis rencontrés sur leur parcours ;
- Promouvoir leurs qualités, en renforçant leur confiance en soi et en leur montrant comment mobiliser leurs ressources ;
- les aider à s’Intégrer dans le tissu familial, sociétal et professionnel qui forme leur cadre de vie.
La fondation assure le suivi d’enfants, d’adolescent·es et de jeunes adultes, elle leur offre l’assistance psychique, sociale et éducative nécessaire à leur insertion sociale, et elle soutient, en cas de besoin, leurs familles. Aussi l’aide dispensée s’adresse-t-elle prioritairement à des jeunes qui ont des difficultés de (ré)insertion sociale et socioprofessionnelle.
En 2021, l’EPI s’est occupée de quelque 300 jeunes : 129 adolescent·es âgé·es entre 12 et 17 ans, et 112 jeunes adultes qui soit lui ont été confié·es par l’Office national de l’enfance (ONE), soit ont demandé de leur propre gré le soutien de la fondation. Il s’y est ajouté 56 bénéficiaires de protection internationale (BPI), dont la plupart étaient âgé·es de moins de 25 ans.
Les origines de l’EPI remontent aux années 1980, époque où la direction et le personnel du Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE) de Schrassig créèrent une structure associative ayant pour vocation d’épauler les interventions étatiques en faveur des pensionnaires du CSEE. Dès les années 1990, cette association sans but lucratif a su s’émanciper en développant ses propres créneaux d’intervention en faveur des jeunes qui sortaient d’une mesure de placement judiciaire ou risquaient un tel placement par décision du·de la juge de la jeunesse. Pour éviter la réactivation d’une mesure de placement suspendue ou pour prévenir une première mesure du genre, la personne adolescente se voyait et se voit toujours offrir la possibilité d’accepter un suivi de la part de l’EPI. En 1998, cette dernière a obtenu le statut d’une association d’utilité publique, consolidant ainsi son image de marque et autorisant ses donateur·rices à déduire fiscalement les aides accordées. Enfin, la volonté d’aligner le cadre juridique de l’EPI aux activités prestées sur le terrain a incité l’ASBL EPI à se transformer à la fin des années 2010 en fondation d’utilité publique.
L’EPI est restée fidèle aux objectifs qu’elle s’était fixés dès sa création : offrir aux jeunes une aide ambulatoire de haute qualité, en renonçant à toute forme d’accueil de jour ou d’hébergement de nuit, sauf pour ce qui est de son offre de quelques rares possibilités de logement encadré. Sur base des expériences acquises, l’offre initiale a été étendue par étapes et de nouveaux services répondant aux besoins constatés sur le terrain ont été progressivement créés.
La fondation met l’accent sur un accompagnement fondé sur un dialogue participatif des jeunes pris·es en charge, leur permettant de s’exprimer sur les questions qui les intéressent (art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant), tout en leur assurant la protection à laquelle ils·elles ne peuvent pas, le cas échant, prétendre du fait d’être privé·es de leur milieu familial (art. 20). Or, si faire se peut, l’EPI essaie de prodiguer son aide en maintenant le·la jeune dans sa famille d’origine (art. 3, 9 et 19 de la Convention).
Aujourd’hui, une équipe de 20 agent·es, notamment des psychologues, des pédagogues, des assistant·es sociaux·ales et des éducateur·rices gradué·es, gère les quelque 300 personnes suivies et vient d’une manière ou d’une autre en aide à des jeunes en situation de détresse. La gouvernance est assumée par un conseil d’administration composé d’une demi-douzaine de bénévoles qui ont été d’accord pour mettre au service de la fondation leur expérience, leur savoir professionnel et leurs relations sociétales.
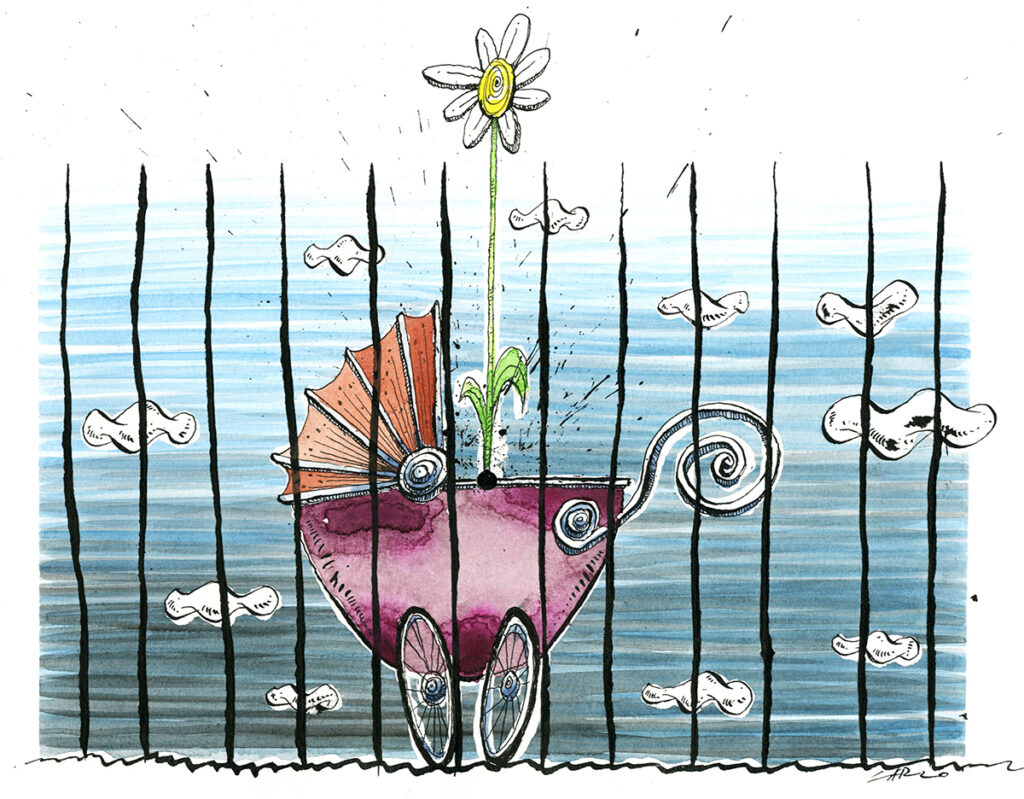
Comment sont organisées les activités de la fondation ?
Le Service Follow Up, qui emploie 8 agent·es, assure l’assistance psychique, sociale et éducative de jeunes que l’ONE a confié·es à l’EPI. Ce travail s’aligne sur les exigences de l’article 39 de la convention précitée, qui demande la réinsertion sociale des enfants victimes d’une exclusion ou menacés d’exclusion. Il s’agit d’un travail normalement de nature préventive, mais qui a porté, par exemple en 2021, dans quelque 25 % des cas sur la réinsertion familiale d’un·e jeune sortant d’une mesure de placement. Les agent·es du Follow Up soutiennent les parents dans leurs tâches éducatives, aident les jeunes à réintégrer leurs familles respectives, accompagnent les jeunes et leurs familles dans les démarches administratives, contribuent à atténuer les problèmes au sein du système familial… Plus de 80 jeunes ont profité en 2021 du suivi offert par le Service Follow Up. L’EPI note que les suivis assurés ont tendance, depuis plusieurs années, à durer plus longtemps et demandent des soins plus intensifs, de sorte que le nombre des prises en charge a dû être réduit.
Les trois psychologues et psychothérapeutes du Service psychologique interviennent notamment en situation de détresse d’un·e jeune. Ils accordent leur aide pour surmonter des souffrances psychiques (surmenage, burn-out, dépression, phobies, pensées suicidaires… souvent à la suite de maltraitances, de la perte d’un être cher, du divorce des parents…) ou pour renforcer des compétences sociales défaillantes (gestion des émotions, renforcement de la confiance en soi, questionnement personnel au niveau de l’orientation, voire de l’identité sexuelle…). Les interventions du Service psychologique, dont ont bénéficié plus de 50 jeunes en 2021, se sont avérées très souvent complémentaires aux missions du Service Follow Up. Le nombre des demandes d’aide en question a d’ailleurs fortement augmenté au cours des dernières années, plaçant l’EPI devant le défi de trouver un ou deux psychologues ou psychothérapeutes supplémentaires pour répondre à la nouvelle demande.
Le Service AISP (accompagnement à l’insertion socioprofessionnelle) se veut un partenaire pour les jeunes à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’un apprentissage… Le service, dont l’effectif est actuellement de trois agent·es, poursuit deux objectifs principaux : soutenir l’adolescent·e ou le·la jeune adulte pris·e en charge dans ses efforts pour s’intégrer dans l’environnement du travail et l’aider à stabiliser sa situation professionnelle et sociale, ceci pendant une phase transitoire plus ou moins longue (dépassant souvent la période d’essai légale). Normalement, un projet socioprofessionnel individuel est élaboré avec le·la jeune, après que ses compétences sociales et professionnelles ont été identifiées et, le cas échéant, renforcées. Le service aide le·la jeune à se trouver une occupation seyant à son profil et à se préparer aux entretiens d’embauche ; il le·la soutient dans ses démarches administratives et lui offre un accompagnement social au début de sa vie active. Sur la centaine de jeunes suivi·es par le service en 2021, 30 ont choisi de retourner à l’école et une vingtaine a pu trouver un emploi grâce à l’aide du service (huit cas) ou s’est inscrite à une formation professionnelle.
L’affluence de nombreux·ses réfugié·es au Luxembourg et les difficultés rencontrées pour accéder au marché du travail une fois obtenu le statut de BPI avait dès 2018 incité l’EPI à mettre sur pied un nouveau service, le Service Inter-C (« C » pour culture, mais aussi pour coaching, créativité, compétence…). L’activité du nouveau service confirme que l’intégration socioprofessionnelle est un processus multifactoriel, long et complexe, dont le succès requiert un accompagnement individualisé des personnes concernées et leur prise en charge globale (régularisation des titres de séjour, recherche d’un logement à la sortie d’une structure d’accueil ou d’une location sociale, familiarisation avec la culture luxembourgeoise et apprentissage linguistique, préparation au marché du travail indigène, stabilisation de la situation sociale et professionnelle après un éventuel engagement…). En faisant bénéficier les jeunes réfugié·es accueilli·es au Luxembourg de la protection et de l’assistance accordées aux ressortissant·es indigènes, la nouvelle activité est en ligne avec l’article 22 de la convention de 1989. Le programme – mis en place en 2018 avec l’aide de la Fondation André Losch, qui a par la suite été relayée par une convention du ministère du Travail et un soutien financier de l’Œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte – se fonde sur l’expérience tirée du travail du Service AISP. En 2021, une trentaine de dossiers ont été gérés par une équipe de quatre agent·es. Avec leur aide, neuf BPI ont pu trouver un emploi (dont deux l’ont hélas perdu par la suite), deux autres ont obtenu un contrat d’apprentissage ou ont pu suivre un stage.
L’EPI est heureuse de pouvoir compter sur un réseau d’instances publiques et d’entreprises partenaires, disposées à appuyer son travail d’insertion des jeunes dans le tissu sociétal et économique indigène.
L’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant porte sur le droit à l’éducation, en encourageant la fréquentation scolaire en fonction des capacités naturelles des jeunes. Nombre de jeunes qui contactent les services de l’EPI ont quitté l’école ou sont sur le point de décrocher. Aussi une des priorités consiste-t-elle à examiner les problèmes à l’origine de cette rupture et voir sous quelles conditions l’abandon scolaire peut être empêché, voire si le retour sur les bancs de l’école est possible. Réussir en la matière tient souvent au dialogue avec les personnes concernées, mais peut parfois aussi requérir l’organisation de cours d’appui individuels, dont le coût élevé oblige l’EPI à chercher de nouveaux mécénats pour disposer des fonds requis.
D’autres jeunes sont sur le point d’entrer sur le marché du travail, tout en ayant un niveau de scolarité très bas. Aussi l’EPI leur offre-t-elle, s’ils·si elles acceptent les conditions d’un suivi, de subvenir aux frais pour l’obtention d’un permis de conduire. En effet, la maîtrise de la conduite automobile s’avère souvent avantageuse pour décrocher un emploi manuel.
Le risque de pauvreté qui progresse au Luxembourg oblige de plus en plus souvent l’EPI à intervenir pour régler des factures impayées, mettre à la disposition d’enfants scolarisés des vêtements ou des effets scolaires, acheter à des familles nécessiteuses des appareils électroménagers ou du mobilier, contribuer aux dépenses de chauffage…
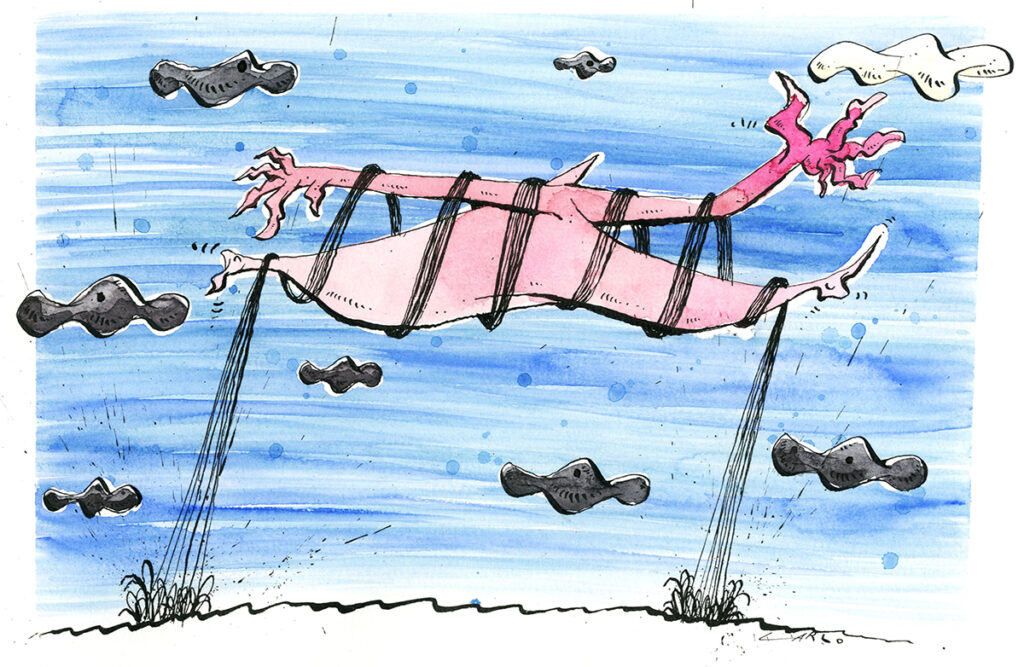
Comment la fondation envisage-t-elle son avenir ?
Grâce notamment à la prise en charge de la rémunération de ses collaborateurs·rices sous forme de forfaits préétablis, accordés par l’ONE, sinon sur base de conventions conclues avec le ministère de l’Education nationale et le ministère du Travail, quelque 90 % des dépenses de l’EPI sont prises en charge par l’Etat. Pour les 10 % restants, la fondation reste tributaire de soutiens et de dons qui lui parviennent de la part de structures actives dans le domaine social comme celles mentionnées ci-avant, d’entreprises privées, de services clubs et de donateur·rices individuel·les, sans la générosité desquel·les l’EPI ne serait pas en mesure de répondre aux missions qu’elle s’est données.
Quant aux perspectives qui se dégagent du projet de loi n° 7994 et à la réorientation qu’il prévoit en matière de protection de la jeunesse, l’EPI croit pouvoir affronter l’avenir avec sérénité. Son objectif d’assurer l’accompagnement de jeunes dans un esprit ouvert de compréhension de leurs problèmes et de leurs ambitions n’en sera pas affecté. Elle pourra continuer à privilégier un accompagnement qui maintient, sinon rétablit, dans la mesure du possible, le milieu familial d’origine des jeunes pris en charge. Consciente de la valeur d’une formation scolaire optimale, elle les encourage à fréquenter l’école et les aide à réussir leurs formations, sinon à leur trouver un travail conforme à leurs compétences. Dans l’esprit de l’article 27 de la convention de 1989, l’EPI continuera à contribuer à l’amélioration de leurs perspectives de réussite dans leur vie affective, sociale et professionnelle.
Paul Schmit est président de la Fondation EPI. Ju-riste de formation et ancien vice-président du Conseil d’Etat, il est l’auteur de plusieurs publications, entre autres dans forum, sur le droit constitutionnel et le droit administratif.
1 Extraits du préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies et approuvée par la loi luxembourgeoise du 20 décembre 1993.
2 Cf. proposition de révision du chapitre II de la Constitution (Droits et libertés, art. 31, al. 2) ; premier vote constitutionnel le 9 mars 2022.
3 Déclaration des droits de l’enfant de la Société des Nations, dite déclaration de Genève, du 26 septembre 1924.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
