- Gesellschaft, Klima
La planète brûle-t-elle ?
Comment parler de la crise climatique avec nos petits-enfants ?
Imaginez que votre médecin traitant vous téléphone afin que vous veniez à son cabinet pour qu’il vous explique les résultats des examens après votre chute accidentelle au jardin. Avec beaucoup de patience et d’empathie, il vous communique une très mauvaise nouvelle : la chute n’a pas causé de fractures, mais une grosse tumeur très suspecte a été décelée par hasard. Une mise au point supplémentaire avec un bilan d’extension doit avoir lieu pour pouvoir débuter la prise en charge.
Quelles seraient vos réactions en rentrant chez vous avec cette très mauvaise nouvelle ? Les médecins se sont certainement trompés (déni) ; vous êtes fâchés contre eux (colère) ; si vous suivez une diète spéciale, peut-être tout s’arrangera (marchandage) ; vous paniquez et envisagez même de vous suicider (désespoir) ; finalement, vous entreprenez tout pour guérir (acceptation).
Voilà les cinq étapes du deuil selon Elisabeth Kübler-Ross – psychiatre helvético-américaine, pionnière de l’approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie – après l’annonce d’une maladie grave, peut-être les mêmes étapes que nous parcourons face à la crise climatique depuis l’annonce des limites de la croissance par le Club of Rome. Après une très longue période de déni des prévisions scientifiques, nous sommes passés au stade de la colère contre les militants et partis écologiques qui ne font que frustrer notre société de productivisme et consumérisme écocides. Au stade de marchandage avec l’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre et le tri de nos déchets… nous entretenons l’illusion de maîtriser notre entreprise d’Hercule ou plutôt de Sisyphe. Depuis 2010, les adhérents de la collapsologie envisagent même les risques d’un effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Tout sera foutu ! Suicide collectif.
« Climate change is a psychological crisis, whatever else it is. » (Bruce Poulsen)
La presque totalité des scientifiques sont tombés d’accord pour ce qui est de la menace du réchauffement climatique mondial. Une grande majorité de la population est bien informée des risques, elle ne refuse plus les faits scientifiques (climate deniers), mais elle a de grandes difficultés à y croire, car les conséquences néfastes ne sont pas encore bien visibles (Giddens’ paradox) ou alors, si c’était vrai, tout le monde devrait quand même agir tout autrement (value-action gap).
Pour démontrer ce dernier comportement, un professeur de psychologie avait fait déclencher l’alarme incendie lors de sa conférence, continuant cependant son enseignement comme si de rien n’était. Etonnamment, tout le monde est resté sur place. Si, par contre, il avait demandé d’aller vérifier dans le couloir pour détecter des indices d’incendie, une panique aurait pu se produire dans l’auditoire.
Le comportement de nos concitoyens peut nous influencer dans une grande mesure. C’est pour cette raison que je comprends et peux accepter l’engagement d’une Greta Thunberg, qui fait bouger les jeunes par des grèves scolaires, ou les actions de militants écologiques, qui se collent aux rues ou jettent de la sauce tomate sur des œuvres d’art (protégées) de peintres célèbres. Pour combattre cette morbide inertie de la population face aux menaces du réchauffement planétaire et malgré tous les appels des scientifiques, ces jeunes activistes acceptent d’encaisser de lourdes sanctions dans le seul but de nous secouer. Combien d’agitations nous faut-il encore pour réagir sérieusement ?
Il y a bien d’autres explications pour comprendre l’immobilisme et l’inaction face à la crise climatique :
- le déficit de connaissances pratiques et le manque de moyens financiers pour passer au changement ;
- l’angoisse, l’impuissance, la « spirale du silence », où l’on évite tout simplement de parler du sujet ;
- les manipulations par des stake- et shareholders qui défendent leurs intérêts économiques ou par des partis politiques qui discréditent les partis écologiques de Verbotspartei, de militants pour une dictature verte… ;
- l’illusion quant aux seuls effets bénéfiques de la décarbonisation de notre économie et les innovations technologiques qui règleront tous les problèmes du réchauffement climatique (technosalvation) ;
- les risques de perdre des privilèges, de renoncer à des habitudes de consommation, de subir des frustrations ;
- la vision apocalyptique, l’inévitable effondrement total nous poussent à bien profiter de tout ce que nous pouvons encore nous permettre maintenant.
Toutefois, du côté des plus riches, beaucoup anticipent déjà les futures tensions sociales et la colère des démunis face aux prochaines pénuries après les effondrements. En 2015, 7 000 millionnaires sont partis de Paris, 5 000 de Rome… pour se barricader dans des gated communities luxueuses et hautement sécurisées1, pour acheter des fermes dans des pays reculés et climatiquement agréables (Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Islande, Irlande, Royaume-Uni) ou pour se construire des bunkers hi-tech luxueux afin de protéger leur famille des catastrophes de toutes sortes2.
Des réactions un peu similaires se constatent du côté des collapsonautes et survivalistes, qui se préparent à survivre en autarcie, en garantissant l’approvisionnement en eau potable, nourriture, énergie, armes, etc.
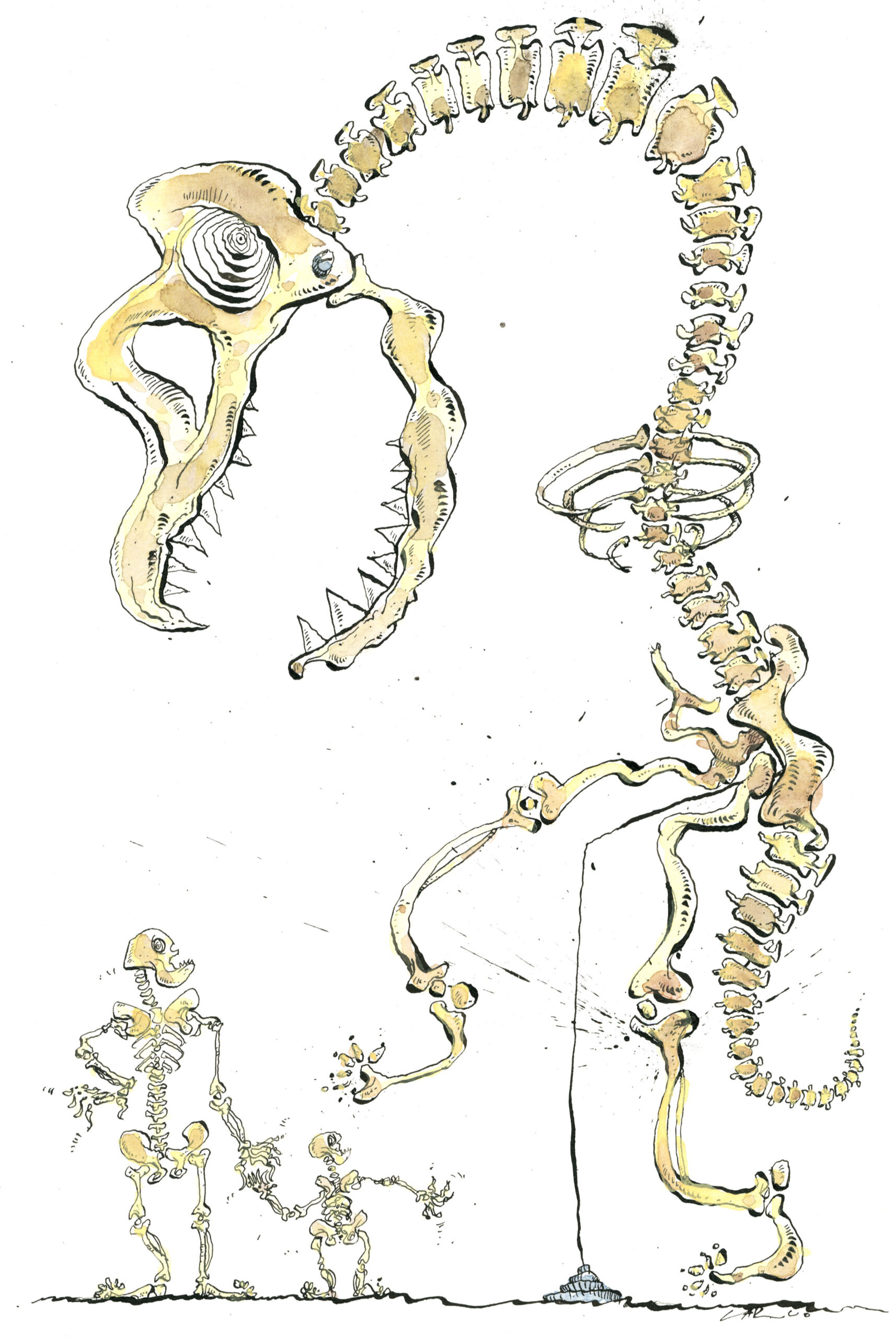
Si les grands changements des politiques climatiques commencent seulement à être mises en place, si la majorité des concitoyens ne réduit pas encore son niveau de consommation, un nouveau phénomène psychologique est par contre en train de se répandre : l’écoanxiété. L’American Psychological Association a défini cette nouvelle pathologie : le syndrome de stress prétraumatique, à savoir le fait de vivre dans un état de stress permanent face à une éventuelle catastrophe à venir. Il s’agit d’une réponse émotionnelle à une situation réelle, et non d’un symptôme de maladie. Ce n’est pas une pathologie ! Sauf si elle devient dysfonctionnelle, trop intense.
Ce sentiment d’anxiété et de peur face aux bouleversements causés par les changements climatiques est ressenti par 83,5 % des jeunes âgés entre 16 et 29 ans au Grand-Duché, selon un sondage réalisé dans le cadre du Youth Survey Luxembourg publié en janvier 20193. Suivant un Eurobaromètre spécial sur l’avenir de l’Europe, publié conjointement avec le Parlement européen et la Commission européenne en 2022, il résulte que 49 % des Européens considèrent le changement climatique comme étant le principal enjeu de portée mondiale pour l’avenir de l’Union européenne4.
Un récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), publié en février 2022, a révélé que l’accélération des changements climatiques constituait une menace de plus en plus grande pour la santé mentale et le bien-être psychosocial, entraînant détresse psychologique, anxiété, dépression, chagrin et conduites suicidaires5. Une étude de 2018 établit pour chaque degré au-dessus de la moyenne lors d’un mois donné que le taux de suicide augmente ainsi de 0,7 % aux Etats-Unis et de 2,1 % au Mexique6. Selon une étude qui analyse les effets psychologiques de la chaleur ou d’autres conséquences du changement climatique – notamment des famines, des sécheresses ou la précarité économique –, chaque augmentation de 1 °C de la température moyenne aux Etats-Unis dans les prochaines décennies pourrait mener à une augmentation de 6 % des crimes violents, soit environ 25 000 décès supplémentaires par année7.
A côté de l’écoanxiété, il existe une autre forme de souffrance existentielle liée aux changements environnementaux déjà éprouvés : la solastalgie, une forme de deuil liée au souvenir d’un lieu de vie détruit ou dégradé. Une souffrance plus fréquemment ressentie par les migrants, les indigènes et les personnes qui pratiquent des métiers de la nature.
Comment peut-on faire des enfants dans ce monde dévasté ? Est-il possible de concilier catastrophe climatique et avenir pour les enfants ?
« We do not inherit the Earth from our ancestors. We borrow it from our children. » (native American proverb)
Nous, les enfants du baby-boom qui avons pleinement profité des avantages de la croissance thermo-industrielle, avec un avenir toujours plus prometteur, nous sommes actuellement les vieux du papy-boom qui appréhendent chaque printemps les prochaines canicules estivales, qui commencent seulement maintenant à avoir honte de leurs nombreux voyages en avion et de leur consommation excessive grâce à des retraites juteuses.
Les petits-enfants du papy-boom, les mêmes qui ont enduré de nombreux sacrifices lors de la pandémie de Covid-19 afin de protéger les personnes âgées vulnérables, remarquent évidemment les changements climatiques causés par notre croissance économique galopante, qui entraînent des dégradations de la nature, la perte de la biodiversité, le rationnement de l’eau potable, l’embrasement de nos forêts et la fonte des glaciers.
De même que j’ai du mal à trouver les mots pour annoncer une maladie grave potentiellement mortelle à mes patients, de même j’ai des problèmes pour expliquer la crise climatique à mes petits-enfants et calmer leurs angoisses y relatives. Quel récit leur raconter quand on a la vie devant soi ? Quel récit optimiste ?
Pour manifester ma solidarité intergénérationnelle, il me reste peut-être seulement le rôle de modèle :
- favoriser les énergies renouvelables ;
- se déplacer en vélo et avec les transports en commun ;
- manger bio et réduire fortement la consommation de viande ;
- consommer moins de manière générale et acheter moins de plastique tout particulièrement ;
- soigner l’entraide, cette solidarité vitale lors des catastrophes ;
- rester en forme physiquement et surtout émotionnellement ;
- leur raconter des histoires positives (stories for future) ;
- … et réfléchir sur ce qui fait encore sens dans la vie ;
- NEVER GIVE UP, papy !
Reduce my ecological footprint and increase our political handprint!
En réduisant individuellement mon empreinte écologique par tous les efforts possibles, je n’arriverai jamais à passer en dessous de la barre des 8 tonnes de CO2 par an, alors que nous ne devrions pas dépasser la limite des 2 tonnes. Il faut également s’attaquer aux limites systémiques de cette empreinte écologique. Il ne suffit pas d’envoyer nos enfants dans les rues le vendredi pour protester, il est grand temps que les papys s’engagent eux-mêmes politiquement pour agir au niveau collectif : lancer des pétitions, réaliser du lobbying politique, investir l’argent épargné dans des projets écologiques durables, devenir militant auprès des grandpas for future, provoquer régulièrement des embouteillages de trafic par notre présence massive de cyclistes portant des gilets jaunes, peut-être même risquer des peines de prison en se collant au tarmac du Findel…
Je n’apprécierais vraiment pas que mes petits-enfants me fassent un jour des reproches quand je serai en maison de soins, comme dans le roman Les Vieux Fourneaux, où Sophie, enceinte, s’adresse à un groupe du troisième âge, sidéré : « Vous êtes inconséquents, rétrogrades, bigots, vous avez sacrifié la planète, affamé le tiers-monde ! En quatre-vingts ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des espèces vivantes, vous avez épuisé les ressources, bouffé tous les poissons ! Il y a cinquante milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde, et les gens crèvent de faim ! Historiquement vous êtes la pire génération de l’histoire de l’humanité ! Et un malheur n’arrivant jamais seul, vous vivez hyper vieux !8 »
Dans Paris brûle-t-il ?, la capitale n’a finalement pas péri, ni dans le film ni dans la réalité. Dans le scénario « La planète brûle-t-elle ? », comment leur raconter honnêtement la fin de l’histoire ? La fin de l’Histoire ???
1 Millionaire migration in 2015 : http://www.invest-data.com/eWebEditor/uploadfile/2016052221524859386884.pdf (toutes les pages Internet auxquelles il est fait référence dans cette contribution ont été consultées pour la dernière fois le
22 mai 2023).
2 Evan OSNOS, « Doomsday prep for the super-rich », dans The New Yorker, 23 janvier 2017.
3 Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Université du Luxembourg, « Le bien-être et la santé des jeunes au Luxembourg », dans le Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg 2020, 2021, p. 148.
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_447
5 https://tinyurl.com/mtsaut3z
6 Marshall BURKE, Felipe GONZALEZ, Patrick BAYLIS, Sam HEFT-NEAL, Ceren BAYSAN, Sanjay BASU et Solomon HSIANG, « Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico », dans Nature Climate Change, vol. 8, 2018, p. 723-729.
7 https://tinyurl.com/ybpar8mh
8 Wilfrid LUPANO et Paul CAUUET, Les Vieux Fourneaux. Ceux qui restent, tome 1, Dargaud, 2014.
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
