
Raymond Weber
Aimé Césaire :
Cahier d’un retour au pays natal
Cahier d’un retour au pays natal est la première œuvre, d’une quarantaine de pages, que l’Antillais Aimé Césaire (1913–2008) a écrite à partir des années 1936[i], alors qu’il était étudiant en France et qu’il prenait conscience du désastre économique et culturel engendré par le colonialisme dans son pays, la Martinique[ii].
Dans ce long poème en prose, Aimé Césaire apostrophe violemment ses compatriotes pour les convaincre de renouer avec leur culture ancestrale, seul moyen d’envisager pour les Antilles un avenir en rapport avec leurs ressources matérielles et spirituelles. Cahier d’un retour au pays natal deviendra ainsi non seulement un texte-étendard de la jeunesse révolutionnaire des pays colonisés, mais aussi un manifeste de base de la « négritude[iii] ».
Chez Césaire, la poésie-musicalité rejoint le rythme de l’oralité de la culture noire. Par ailleurs, l’usage du vers libre est chez lui signe d’affranchissement par rapport aux règles classiques de la culture dominante (celle des colons, dans la langue desquels il s’exprime). Si l’écriture poétique est déjà un geste de libération, qui s’accorde à la revendication politique, Césaire subvertit par ailleurs le langage des colons pour le rapprocher du souffle du rythme africain, donc de ses racines et pour « exprimer l’âme noire avec le style nègre en français », comme l’écrivait Léopold Sédar Senghor, de qui il fut le condisciple à Paris.
Le résultat en est un poème qui chante l’appartenance à un peuple, à une terre ; qui loue le rapport consubstantiel de l’homme à son milieu, à ses racines ; qui invite à se libérer de toute oppression, tout en prônant un esprit de tolérance et d’ouverture à l’Autre ; qui rêve d’accorder à l’homme l’omnipotence divine pour faire respecter la dignité de la condition humaine.
Ainsi, pour Césaire, écrire et agir politiquement vont de pair : « ma poésie est née de mon action », écrit-il ; ou encore, « écrire, c’est dans les silences de l’action ».
Derrière cette parole, c’est celle de tous les Martiniquais noirs descendants d’esclaves qu’il faut entendre et, au-delà, celle de tous les opprimés. Le poète s’en prend à leur passivité, il entend réveiller leur sentiment de révolte et leur rendre leur dignité d’hommes libres. La poésie de Césaire a donc une portée universelle, « car il n’est point vrai que l’œuvre de l’homme est finie / que nous n’avons rien à faire au monde / que nous parasitons le monde / qu’il suffit que nous nous mettions au pas du monde / mais l’œuvre de l’homme vient seulement de commencer / et il reste à l’homme à conquérir toute interdiction immobilisée aux coins de sa ferveur / et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l’intelligence, de la force… ».
Enfin, ce combat permet aussi à l’auteur de se (re)construire en affirmant sa propre identité. Le Cahier d’un retour au pays natal est aussi une œuvre de « refondation ».
Le texte, influencé par le surréalisme, s’est imposé comme une œuvre majeure de la poésie francophone du XXe siècle, grâce à la puissance incantatoire donnée par sa forme poétique si particulière, ainsi que par la révolution lucide qu’il propose. Aimé Césaire a pris la plume pour exposer une prise de conscience, livrer un témoignage, montrer son engagement dans le combat pour la décolonisation. Il somme le lecteur de ne pas négliger la beauté du langage, la force poétique de l’image, propres à réunir.
En 2003, l’acteur et metteur en scène Jacques Martial a créé un spectacle théâtral autour d’extraits choisis de Cahier d’un retour au pays natal. Au début du mois de mars 2020, en ouverture du Mois de la francophonie, le Théâtre national du Luxembourg nous a proposé une autre version, très réussie, de Daniel Scahaise, avec l’acteur burkinabé Etienne Minoungou.
Cahier d’un retour au pays natal est une œuvre qui me « suit » depuis longtemps et dont les relectures fréquentes me font découvrir à chaque fois d’autres aspects. Ce qui me touche le plus dans ce poème épique, c’est cette cohérence entre une volonté forte d’innovation esthétique et formelle et une exigence politique clairement affirmée : « […] aucune pensée ne vaut que repensée par nous et pour nous. Et c’est ici une véritable révolution copernicienne qu’il faut imposer, tant est enracinée en Europe, et dans tous les partis et dans tous les domaines, de l’extrême droite à l’extrême gauche, l’habitude de faire pour nous, de disposer pour nous, l’habitude de penser pour nous, bref l’habitude de nous contester le droit à l’initiative qui est, en définitive, le droit à la personnalité.[iv] » Aucune éthique ne peut se déclarer libre si elle n’invente pas, au péril de son essence, l’esthétique de sa liberté.
« C’est quoi une vie d’homme ? Évidemment, une vie d’homme ce n’est pas ombre et lumière. C’est le combat de l’ombre et de la lumière, ce n’est pas une sorte de ferveur et une sorte d’angélisme, c’est une lutte entre l’espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur, et cela est valable pour tous les hommes, finalement sans naïveté aucune, parce que je suis un homme de l’instinct, je suis du côté de l’espérance, mais d’une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté, parce que je sais que là est le devoir. Parce que désespérer de l’Histoire, c’est désespérer de l’Homme.[v] ».
Pour terminer, en ces temps de confinement dû au coronavirus, une dernière citation du Cahier :
« Et à moi mes danses
mes danses de mauvais nègre
à moi mes danses
la danse brise-carcan
la danse saute-prison
la danse il-est-beau-et-bon-et-légitime-d’être-nègre
À moi mes danses et saute le soleil sur la raquette
de mes mains. »
[i] Cahier d’un retour au pays natal (1939, 1947, 1956, 1971, 1982).
[ii] Deux autres œuvres d’Aimé Césaire pourraient être citées ici : Discours sur le colonialisme (1955, 1970, 2004) et La Tragédie du roi Christophe (1963, 1970).
[iii] « La Négritude résulte d’une attitude active et offensive de l’esprit. / Elle est sursaut et sursaut de dignité. / Elle est refus, je veux dire refus de l’oppression. / Elle est combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité », extrait d’un discours qu’Aimé Césaire a prononcé en 1987 à l’Université internationale de Floride (Miami).
[iv] Lettre à Maurice Thorez, 1956.
[v] Aimé Césaire, dans une entretien avec Daniel Maximin, Paris, 1982 (à l’occasion de la publication du recueil Moi, laminaire et de la réédition du Cahier d’un retour au pays natal).
Raymond Weber, ancien fonctionnaire national (au Ministère de la Culture) et international (à l’UNESCO, au Conseil de l’Europe et au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest – OCDE) reste aujourd’hui engagé dans les domaines de la politique culturelle (Forum Culture(s)) et de la coopération au développement (SOS Faim et Cercle de Coopération des ONGD). Sa dernière contribution à forum: « La démocratie culturelle comme fondement de la démocratie », dans forum 403, février 2020, p. 44-52.
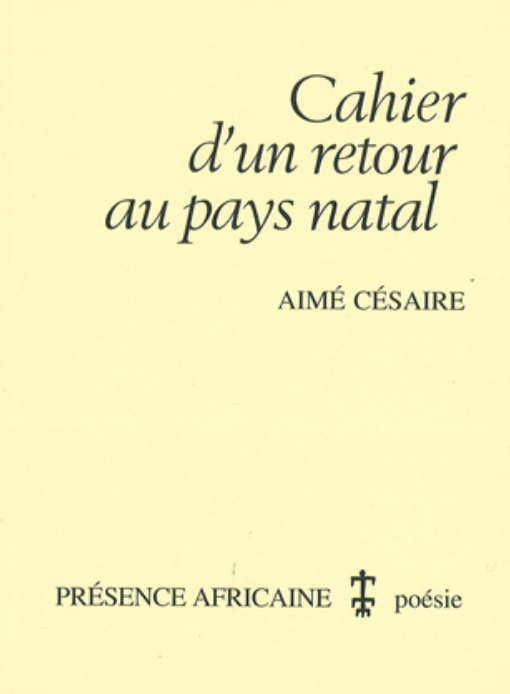
Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.
Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!
